
Les moyens de détection des exoplanètes :
Après avoir vu quelles sont les conditions nécessaires pour qu'une exoplanète soit habitable, voyons désormais quels sont les moyens de détection d'une telle planète. Dans les films de science-fiction, malheureusement, ce sujet est peu abordé, voir pas du tout ! Le sujet n'intéresserait pas le grand public qui ne disposerait pas forcément des connaissances requises pour l'appréhender et s'ennuierait. Pour autant, ce sujet est l'un des points les plus importants de l'avenir de l'homme ! Sans moyens de détection, il n'y aurait pas de détection d'exoplanète et encore moins de renouveau scientifique.
Pour observer l’espace, nous avons besoin de télescopes mais pas de n’importes lesquels ! Ceux présents sur Terre rencontrent un problème majeur : la présence de l’atmosphère qui empêche les mesures précises. En effet, nous avons besoin de télescopes spatiaux car ils ont une observation directe sur le spectre de l’étoile, sans être influencés par le spectre de l’atmosphère. Ce dernier spectre fausse les résultats et empêche une détermination précise des étoiles et donc des exoplanètes.
Comment marche un télescope spatial ?
Son principe est similaire aux téléscopes situés sur Terre. Cependant, il est un peu plus complexe. Le téléscope spatial peut être situé en orbite autour du Soleil, de la Terre ou autour d'autres planètes. Il comprend deux types de matériel bien précis.
Tout d'abord, il contient du matériel de fonctionnement :
-
les batteries sont les sources d’énergie,
-
les appareils de chauffage servent à maintenir les composants à une température supportable,
-
les appareils de mesures servent à contrôler le fonctionnement du télescope depuis la Terre, à vérifier son état et son orientation,
-
les appareils de contrôle servent à orienter le télescope et à le déplacer grâce à des systèmes de propulsion auxiliaire; ils contrôlent les communications et les instruments scientifiques,
-
les panneaux solaires servent à recharger les batteries; ils sont solides et résistants pour parer à d’éventuels débris spatiaux.
Ensuite, il contient du matériel scientifique, dernier cri et très précis. Ce matériel va remplir le principal rôle du télescope en détectant les étoiles et peut-être une exoplanète :
-
L’ACS (Advanced Camera for Surveys) est un appareil photo avec une excellente qualité d’image.
-
Le FGS (Fine guidance sensor) est la partie optique du télescope, servant aussi de détecteur. Il est constitué de miroirs, de lentilles et de prismes.
-
La WFC3 (Wide Field Camera 3), le COS (cosmic origin sensor) et le NICMOS (Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer) sont des caméras qui voient loin dans l’ultra-violet et l’infrarouge. Elles possèdent un grand champ chromatique.
Dans l'histoire de la chasse aux exoplanètes, il faut retenir trois grands télescopes :
-
Hubble, lancé en 1990, a connu de nombreux problèmes de conception. Il a tout de même détecté les premières exoplanètes et ainsi lancé la chasse. Hubble est aujourd'hui hors service et ce depuis 2010 après 20 ans de services et de découvertes tels que l'existence des trous noirs ou de la matière noire.
-
Kepler, lancé en 2009, a été développé par l'agence américaine spécialement pour l'étude des exoplanètes. Il en a découvert près de 1700 par la méthode des transits, que nous allons voir prochainement. Ce satellite est aujourd'hui en panne, en raison du refus de la Nasa de réparer les roues endommagées.
-
James-Webb qui remplacera prochainement Hubble. Il devrait nous en dire plus sur les exoplanètes. Développé par l'agence spatial européenne et canadienne pour un lancement prévu en 2018, ce satellite est à la pointe de la technologie et donc plus puissant, notamment par le fait que son optique est 7 fois plus important que celui de Hubble.
Contrairement à ce que l'on peut penser, les exoplanètes ne sont pas détectées par le télescope. Ce dernier ne fait que récolter des données brutes qui sont ensuite envoyées sur Terre pour être plus amplement analysées par des scientifiques. Ceux-ci découvrent les exoplanètes grâce à des lois et des méthodes de la physique bien précis.
Comment déceler des planètes extrasolaires ?
Plusieurs méthodes sont employées et chacune est spécifique à la position de l’exoplanète dans le système planétaire. Elles permettent également de calculer les propriétés de l’exoplanète (atmosphère, orbite, excentricité, demi-grand axe).
Quels sont les différents moyens de détection ?
Les moyens de détection d'exoplanètes sont soit directs, soit indirects.
La technique la plus employée est celle indirecte, consistant à surveiller les perturbations inhabituelles que peut subir une étoile. En effet, l’exoplanète influence son étoile. Cela provoque des variations inhabituelles dans l’orbite de l’étoile et/ou une modification de la luminosité perçue depuis la Terre.
La première méthode de ce type est la méthode du transit. Il s’agit de la mesure de très faibles diminutions de la luminosité d’une étoile dues au passage de l’exoplanète entre l'étoile et la Terre lors de son orbite. Cette méthode est surtout efficace pour repérer de grosses planètes en orbite rapprochée. Il est impossible depuis la Terre de détecter des baisses de luminosité de moins de 1% (une planète de la taille de la Terre induit une baisse de 0,1 %). Cette méthode n'est donc pas la plus efficace. Cependant, elle fournit des informations plus précises sur la masse et l’orbite de la planète. Elle permet également de calculer la taille de la planète : plus cette dernière est grande, plus la baisse temporaire de luminosité est marquée.
La seconde méthode, qui a permis de détecter 51 Pegasi b, est la méthode de vélocimétrie par l’effet Doppler-Fizeau, également appelée la méthode de la vitesse radiale. Le système étoile-planète est en mouvement autour du centre d’inertie de celui-ci et on observe des variations dans le spectre lumineux de l’étoile. En effet, tout comme l’étoile exerce une force d’attraction gravitationnelle sur la planète, cette dernière produit une force égale et opposée sur l’étoile mais vu la masse de l'étoile, l'effet de cette force est faible. La méthode de la vitesse radiale cherche donc à mesurer de petits changements de vitesse plutôt que de position de l’étoile. Une grande précision de mesure est alors nécessaire, le mouvement de l’étoile étant très ténu (équivaut à observer une oscillation de Jupiter de l’ordre d’une pièce de 2 € ). Comme l’étoile s’éloigne de l’observateur, les raies de son spectre sont décalées vers le rouge puis l'étoile se rapproche, le décalage s’effectue cette fois vers le bleu. Cependant, il s’agit d’une technique destinée à des étoiles proches. Ces fluctuations sont toujours très faibles et ne sont généralement détectables que lorsque la planète produit d’importantes perturbations gravitationnelles. Cette méthode de la vitesse radiale se limite également aux planètes massives comme les géantes gazeuses, et uniquement si ces planètes sont plus proches de leur étoile que Mercure de notre Soleil. Lorsque ces conditions sont réunies, des observations spectroscopiques très précises peuvent révéler la planète et fournir approximativement sa masse et des informations sur son orbite.
La méthode des lentilles gravitationnelles est la mesure de l’amplification de la lumière d’une étoile lointaine, par effet de « loupe gravitationnelle », causée par le passage en avant plan d’un système étoile-planète. D’après la relativité générale, les rayons lumineux qui nous proviennent de l’étoile lointaine sont légèrement déviés au passage de la plus proche. Ceci peut produire des effets d’optique comme des images multiples de l’étoile lointaine ou une augmentation de sa luminosité apparente. Elle permet la détection de planètes de faible masse et éloignées de leur étoile. L’observation n’est pas prévisible à l’avance et n’est pas reproductible. Elle nécessite un champ stellaire dense pour augmenter les chances de passage devant une étoile plus éloignée.
L’astrométrie est la mesure des changements de la position angulaire de l’étoile dans le ciel afin d’apprécier son oscillation autour du centre de gravité du système étoile-planète. Cette technique permet de détecter les planètes à longues périodes orbitales autour d’étoiles peu massives et proches de nous.
La détection directe telle que l’imagerie directe est difficile à utiliser à cause du rapport d’éclairement étoile/planète (1/10E8). En effet, il conduit à l’éblouissement et on ne peut pas déceler la présence de planètes autour de cette étoile. La chaleur de la planète est elle aussi cachée. Cependant les renseignements donnés par l’imagerie directe sont plus précis et plus nombreux.
La coronographie est une technique, en astronomie, qui consiste à reproduire le phénomène céleste des éclipses totales. Le coronographe permet en effet d'effacer la partie centrale de l'étoile. Ainsi, seule la couronne de l'étoile observée apparaît, car elle n'est plus « noyée » par la lumière de la photosphère ou le disque stellaire.
La méthode du flux réfléchi et du flux thermique consiste à percevoir la lumière d’une planète. Il y a deux régimes possibles : la lumière de l'étoile réfléchie par la planète et l'émission thermique de la planète chauffée par l'étoile. Ces méthodes permettent de déterminer si une planète est habitable.
Toutes ces méthodes sont donc des moyens incontournables pour repérer les exoplanètes dans un premier temps, et dans un autre temps pour disposer d'informations précises et qui le sont de plus en plus au fur et à mesure du temps. Nous pensons que sans ces moyens et sans ces outils astronomiques, le voyage dans l'espace est une perte de temps et d'argent. C'est donc bien un modèle de l'avenir de l'homme.
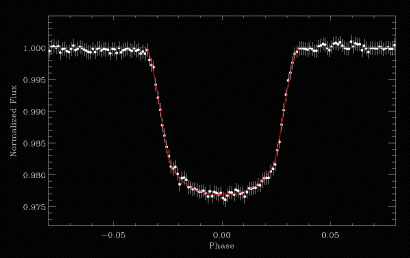
La courbe de lumière d’un transit d’exoplanète observé par le satellite Corot en mai 2007. Source : CoRoT exo-team
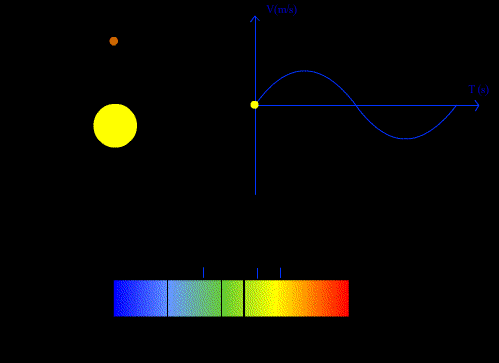
Méthode des vitesses radiales :
L'étoile sous l'influence de la planète s'éloigne et se rapproche de nous périodiquement, le spectre de l'étoile se décale vers le bleu puis vers le rouge. On en déduit la vitesse radiale de l'étoile et donc la présence d'une planète.
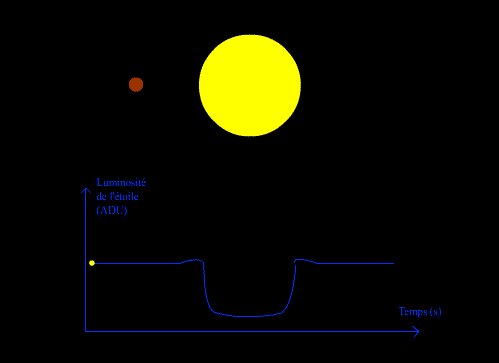
Méthode des transites :
La planète en passant devant son étoile cache une partie de sa lumière, donc sa luminosité apparente diminue, d'où la courbe de lumière en cloche inversée. On peut donc en déduire la présence d'une planète.
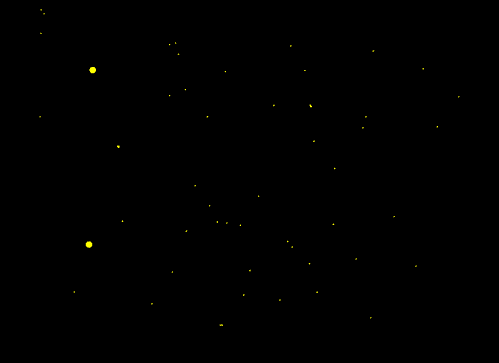
Méthode de l'astrométrie :
La planète, en tournant autour de son étoile, ne permet pas à l'étoile de voyager en ligne droite mais en zig-zag. En haut, la trajectoire de l'étoile par rapport aux autres étoiles plus lointaines. En bas une étoile sans compagnon et donc voyageant en ligne droite.

La couronne solaire vue par le coronographe LASCO C1. source: Wikipédia



Télescope Hubble
Télescope Kepler
Télescope James-Web